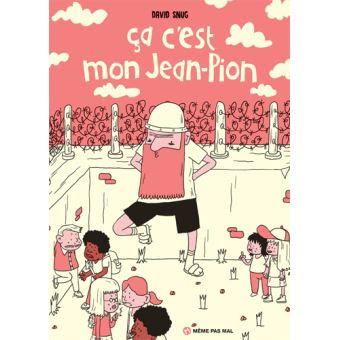C'est en écoutant un épisode du podcast La Poudre que j'ai entendu parler de l'écrivaine Dali Misha Touré ; lors de son entretien avec Lauren Bastide, elle a évoqué le roman Cicatrices, publié en 2020 chez Hors d'Atteinte, une maison d'édition indépendante et féministe. Agée de seulement 25 ans, l'artiste a déjà plusieurs textes à son actif.
Cicatrices - Dali Misha Touré (2020)
Quelque part dans une banlieue proche de Paris, derrière les murs d'une cité, une jeune fille de dix-sept ans vient de se lancer dans l'écriture. Pour sa première œuvre, elle choisit de nous raconter son parcours chaotique, depuis une enfance difficile au sein d'une famille nombreuse où elle a eu du bien du mal à se faire une place, jusqu'à son présent incertain et endeuillé, mais enfin apaisé.
Dès ses premières années, la petite fille perçoit que le bien et le mal ne s'opposent pas, mais s'entremêlent un peu partout, y compris en nous-même. On peut être à la fois bon et cruel, joyeux et sombre. On peut tour à tour aimer, craindre et détester une même personne ; c'est précisément ce qu'elle ressent pour ses parents, ses frères et sœurs et ses trois belles-mères. C'est aussi ce qu'ils ressentent pour elle, vraisemblablement, du moins lorsqu'ils remarquent sa présence.
En effet, l'héroïne nous explique qu'elle a grandi dans une famille polygame et nous raconte sans jugement et sans tabou à quoi ressemblait son quotidien lorsqu'elle était petite : les jeux, les coups, le manque d'intimité, l'affection ou le rejet récoltés en fonction de l'humeur, les affinités plus ou moins prononcées entre des individus qui n'avaient jamais qu'un homme pour dénominateur commun.
Pour un lecteur qui n'a que des monogames dans son entourage, il est très intéressant de lire un texte qui parle d'une famille polygame librement et surtout sans le mépris qui va parfois avec. Attention, comme Dali Misha Touré le dit dans le podcast de Lauren Bastide, il est question ici d'une façon de vivre parmi tant d'autres. De même qu'il n'y a pas un schéma type de familles monogames, les familles polygames ne sont pas toutes identiques. Bref, ce n'est là qu'une facette du livre sur laquelle j'avais envie de revenir ; elle ne représente pas à elle-seule tout l'intérêt des Cicatrices.
Attention, je vais spoiler un événement majeur
qui se produit à la fin du livre.
Arrêtez-vous là si vous voulez découvrir Cicatrices par vous-même.
"Surtout, j'entendais toujours la voix de ma mère. Elle aimait me crier dessus et m'insulter. Je ne disais rien, mais ça me faisait mal".
Comme beaucoup de personnes _j'imagine..._ qui ont toujours vécu dans les coups et les brimades, l'héroïne (bordel ça saoule un peu qu'elle n'ait pas de nom quand même, je commence déjà à galérer pour la désigner) cherche des excuses à ses bourreaux et s'attache à voir le mon côté des choses : elle mange à sa faim, a un toit et des vêtements, va a l'école. De quoi se plaindrait-elle ? Le cercle vicieux des mauvais traitements l'amène même à sublimer en moments inoubliables, le recul des années et la nostalgie aidant, les quelques rares instants à peu près sympas partagés avec ses parents : une fête, une embrassade à l'hôpital, une conversation téléphonique où on dit du bien d'elle.
Dali Misha Touré nous montre fort bien comment l'environnement participe à la construction d'une personne, comment elle peut, combinée avec d'autres facteurs, bien sûr, façonner une personnalité. Ce n'est pas pour rien que le livre s'intitule Cicatrices, faisant directement références aux marques physiques et surtout psychologiques que peuvent laisser nos semblables lorsqu'ils sont dépourvus de bon sens et/ou d'empathie. Parce qu'on ne la remarque pas toujours, la jeune fille va tenter de se distinguer en foutant le bordel au collège ; parce qu'on l'a empêchée de sortir de la maison jusqu'à son adolescence, elle désertera la maison dès qu'elle pourra le faire, et goûtera à tous les interdits. Parce qu'elle n'aura eu aucune "chambre à elle", au sens propre comme au figuré, dans toute sa jeunesse, elle s'attachera à lire et à écrire pour se créer un univers connu d'elle seule.
D'ailleurs, sa mère ne s'y trompe pas : elle voit rouge dès qu'elle la chope en train d'écrire, et pour cause : n'ayant pas bénéficié d'instruction et ne connaissant que peu le français, elle comprend qu'elle peut perdre le contrôle de cette enfant qui l'embarrasse mais qui ne doit en aucun cas lui faire honte. Elle va le perdre malgré tout, ce contrôle, puisque la jeune fille n'aura bientôt plus aucun scrupule à jouer sur les points faibles de ses parents pour servir ses propres intérêts : c'est de bonne guerre, après tout. Elle encaisse les coups, mais apprend petit à petit à les rendre, à sa manière. Jamais la narratrice ne se présentera comme une fille modèle. Jamais elle ne manifestera une quelconque culpabilité.
Peut-être l'autrice choquera-t-elle une partie de son lectorat en peignant une héroïne qui verbalise le souvenir ambivalent qu'elle garde de son père après sa mort : celui, d'un homme classe et beau à sa manière, droit, respectable, mais au comportement exécrable, voire sadique, avec ses femmes et ses enfants. La faucheuse ne fait pas tout : un con mort reste un con.
"J'étais très triste à l'idée que je ne reverrais plus jamais mon père, mais je repensais aussi à tout le mal qu'il m'avait fait. Je ne pouvais pas l'oublier, il était ancré en moi. Une profonde cicatrice que je n'oublierais jamais.
Sa personne me manque, mais ses cris ne me manquent pas, ni la ceinture avec laquelle il nous frappait. J'aurais tellement voulu raconter à mes parents, plus tard, que j'avais eu un père merveilleux. [...] Tout le monde ne peut pas avoir des parents gentils."
Le roman Cicatrices, ne contient aucune indication précise de lieux, aucune date, très peu de noms... sans doute parce que l'histoire de l'héroïne est universelle à bien des égards. Sachez juste que la narratrice, qui retrace ici sa vie à la première personne, est un personnage fictif, bien distinct de l'autrice Dali Misha Touré. Il me semble que c'est important de le signaler afin de pouvoir mesurer le talent de cette jeune écrivaine aulnaysienne, capable d'habiter son personnage principal au point de nous donner l'impression qu'on lit un récit autobiographique.
Bien entendu, le décor et les protagonistes sont teintés de réel, de situations vues ou vécues : les dialogues mêlant soninké et français, l'allusion à Matilda, le roman de Roald Dahl souvent lu au collège, la "vie de la cité", les sorties à la Gare du Nord et à Châtelet. Mais en aucun cas elle ne raconte sa vie. C'est fascinant d'arriver à parler aussi clairement de situations traumatisantes, lorsqu'on ne les a pas vécues ; il doit falloir, en plus d'un don nature, une dose d'empathie considérable.
Cicatrices est un livre aussi facile à lire qu'il est dur à encaisser ; peut-être y a-t-il des passages qui vous feront tiquer, tels que le traitement un peu rapide de la phase de "crise d'adolescence" que la narratrice semble regretter amèrement, alors qu'elle marque un détachement casse-gueule mais nécessaire avec une famille toxique, que seuls la mort du père et le vieillissement des belles-mères pourront assainir. Ou encore le portrait de Camille, la meilleure amie de l'héroïne, qui est un bon cliché de la petite babtou menant une vie de princesse dans son pavillon aseptisé, auprès de parents pleins aux as qui s'aiment comme au premier jour. Même si on sait que Dali Misha Touré ne fait qu'écrire ici la vision idéalisée et imparfaite que la petite fille a de sa copine, certains trouveront matière à dire que "non, c'est pas ça" !
Vous le constaterez en le lisant, ce roman choc se termine sur une note d'espoir et de changement, incarnée par le personnage de la mère qui semble renaître à la mort du père. Peut-être pressent-elle que sa fille n'est plus un petit être braillard, mais le futur pilier de ses vieux jours ? Veut-elle vraiment racheter ses erreurs passées ? Chacun interprètera à sa guise. Toujours est-il qu'en devenant soudain attentive, encourageante, aimante... tout ce qu'elle n'avait jamais été jusque-là, sans doute parce qu'elle était trop tourmentée par la douleur de ses propres plaies, sa fille se sent pousser des ailes. Et ose enfin écrire.
Cette découverte ne m'a pas laissée indifférente et le compte-rendu que j'en fais n'est sans doute pas neutre ; j'ai compris les propos tenus et le style d'écriture avec mes clés de lecture, et je l'ai lu avec les yeux de quelqu'un qui a eu la chance d'échapper aux déboires connus par l'héroïne. Lisez-le à l'occasion, vous y verrez sans doute des choses qui ont dû m'échapper ! Pour les Parisiens, il est à la médiathèque de la Canopée (enfin quand je l'aurai ramené, ahah).
Public visé : jeunes adultes / adultes. Accessible dès la fin du collège ; ce n'est pas tant le niveau de lecture que la sensibilité de l'enfant qui déterminera l'âge adéquat.
Si jamais quelque chose vous froisse dans ce billet, faites-le moi savoir en commentaire !
- L'épisode de La Poudre consacré à Dali Misha Touré.
- Voici un lien vers un petit article de TV5 Monde sur Dali Misha Touré.
Dali Misha TOURÉ. Cicatrices. Hors d'atteinte, 2020. 132 p. ISBN 978-2-490579-04-4