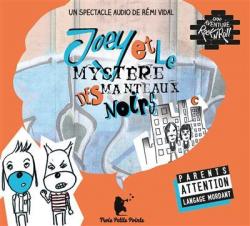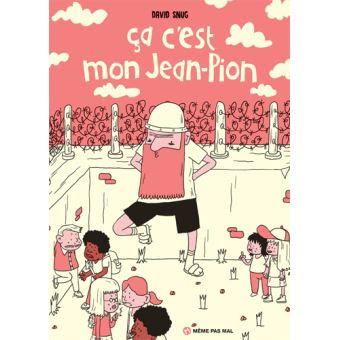Au club lecture, ma pote Nathalie la prof de lettres et moi-même avons essayé de déterminer un "fil rouge" afin de fidéliser les élèves, toujours volontaires au lancement mais parfois surpris d'avoir un minimum d'investissement à fournir, ou juste déçus de constater qu'à un moment, bah il faut bien lire un peu, quand même. A l'inverse, d'autres quittent le navire car ce sont de bons lecteurs qui ont déjà quelques longueurs d'avance sur le fonds du CDI. Je n'ai jamais réussi à trouver le bon équilibre, mais j'y travaillerai autant qu'il le faudra.
 |
Remember l'ancien collège !
Vous trouvez que c'était assez mignon, finalement, sous cet angle-là, hein ?
Eh bien ça n'existe plus !!! |
Cette année, on a donc expérimenté un thème général "héroïnes et héros" de la littérature ou de la bande dessinée. De mon côté, ce rendez-vous hebdomadaire me donnait l'occasion de réinvestir le travail autour des super-héros fourni lors de ce fameux "atelier comics" amorcé en 2020 et tué dans l'œuf par le Covid. Le recoupement avec le programme de français en 5ème nous assurait d'avoir de la matière sous le coude en cas de pépin dans la préparation des rendez-vous.
Après avoir consacré des séances à Miss Marvel, à Percy Jackson, au Journal d'un dégonflé, on a sondé les enfants pour savoir s'ils avaient envie qu'on parle d'un personnage en particulier, et ils ont été nombreux à proposer Black Panther. Peut-être parce que le film Wakanda forever sortait à ce moment-là au cinéma. On ne connaissait rien ni l'une ni l'autre sur ce personnage, mais on leur a promis de faire acquisition d'une BD centrée sur ce héros Marvel afin d'en parler avec eux.
Ne sachant pas trop comment entrer dans l'univers, j'ai opté pour le tome 1 de la série Black Panther paru chez Panini en 2018, dans la collection "Marvel Select". Il s'agit d'une réédition des douze premiers chapitres d'une série qui en compte 72 au total ; elle est née de la plume de Christopher Priest et de Mark Texeira vingt ans plus tôt.
L'histoire
Une sordide affaire secoue le Fonds Tomorrow, un organisme d'aide à l'enfance implanté à Brooklyn et soutenu par T'Challa, roi du Wakanda, plus connu sous le nom de Black Panther. On y a récemment assassiné une fillette de sang froid, avant de détourner de l'argent. La totale. Lorsqu'il apprend la nouvelle, le roi T'Challa déserte le trône en urgence et file aux États-Unis pour régler leur compte aux malfrats.
Il laisse derrière lui un pays en proie à de nombreux affrontements entre les Wakandais "citadins", les "Tribus des Marais", et les réfugiés _accueillis à bras ouverts par le roi mais clairement rejetés par les citoyens. C'est tout sauf le moment de partir, mais il n'a pas le choix.
Au même moment, l'agent Everett K. Ross se voit confier la mission d'accueillir le roi du Wakanda et d'assurer sa sécurité pour la durée de son séjour à New-York. Bien qu'il soit de bonne volonté, il est vite dépassé par la situation se fait rapidement balader par le super-héros qu'il escorte. Peut-on lui reprocher de ne pas arriver à gérer un Avenger ?
Black Panther mène son enquête et découvre qu'un certain Achebe est à l'origine de la mort de la fillette du Fonds Tomorrow. Il comprend par la même occasion qu'il s'est fait manipuler par ce type qui n'avait qu'un seul but : pousser T'challa à s'éloigner le plus possible du Wakanda, et tenter de prendre le contrôle du pays en son absence.
Achebe s'avère n'être pas plus qu'un fou relativement limité, incapable de manigancer des projets de grande envergure ; le "vrai méchant" se cache derrière lui, tapi dans l'ombre, agissant de façon sournoise, pénétrant les consciences pour arriver à ses fins.
Le roi T'Challa va lui-même faire les frais de son pouvoir invisible, et revivre des souvenirs difficiles enclins à lui mettre le doute. Pourra-t-il s'en relever avant que son pays ne parte en vrille ?
Attention, la suite du billet dévoile des infos que vous gagnerez à découvrir par vous-même si vous comptez lire la bande-dessinée !
Les défauts de ses qualités
Après coup, je ne pense pas qu'Ennemi d'état puisse servir d'entrée principale dans le petit monde de Black Panther ; cependant, ça reste une porte dérobée tout à fait efficace, puisqu'on a de nombreux flashbacks sur les origines du héros, sur sa jeunesse, ses rapports en demi-teinte avec son père le roi T'Chaka, sa prise de pouvoir à la mort de ce dernier.
La comparaison au patriarche charismatique reviendra à de nombreuses reprises dans l'album, et elle sera rarement à l'avantage de T'Challa. Il faut dire que Black Panther n'a pas du tout la même façon de gouverner que son père : les Wakandais lui reprochent de ne pas avoir la poigne de son prédécesseur, d'être idéaliste et pas assez "stratège".

Cela se vérifie au fil des chapitres : on se rend compte que T'Challa se retrouve souvent dans de sales draps parce qu'il a trop vite fait confiance à tel ou tel pèlerin douteux. On a l'impression que le roi du Wakanda se fait assez facilement berner parce qu'en tant que "gentil", il n'anticipe pas la fourberie des autres. C'est ce qui fait de lui un héros assez attachant en dépit de ses crises de colère et de sa frustration bien perceptible de ne pas pouvoir faire tomber de têtes sur le territoire US. Vers la fin, on comprendra qu'il y a une part de bluff dans tout ça _ T'Challa ne tue en aucun cas, mais on dirait bien qu'il ne veut pas que ça se sache.
Quant aux micro-retournements de situation dans les derniers chapitres, sur fond de "non mais j'ai fait semblant de tomber dans les pièges, j'avais tout compris depuis le début", ils sont un peu difficiles à avaler, je trouve.
Everett K. Ross, le roi de la digression
Pourtant, j'ai pris le temps de relire deux fois ce titre afin d'en juger. C'était nécessaire pour deux raisons.
Premièrement, parce que je ne suis toujours pas familière des comics et des figures emblématiques de l'univers Marvel. Or, les super-héros sont nos chevaliers de la Table Ronde à nous : il vaut mieux avoir une culture des personnages, de leur caractère, de leur parcours pour bien comprendre les réactions, les associations des uns avec les autres, le chemin que prend l'histoire.
Ensuite, la lecture est rendue difficile à cause du choix narratif de faire raconter les événements par le brave Everett K. Ross, pas plus doué pour les comptes-rendus que pour le reste ! De digression en flashbacks en passant par les erreurs de parcours et les "ah, au fait, j'ai oublié qu'avant il s'est passé tel truc", c'est un vrai casse-tête pour le lecteur. Mais lorsqu'on est entré dans le délire, ça devient marrant de se laisser porter et de revenir quelques pages en arrière si besoin.
Du coup, je m'interroge sur la pertinence de mettre ce titre entre les mains des 4°-3° : s'il est loin d'être "trash", beaucoup risquent de se décourager entre les pages titrées on ne sait trop pourquoi, l'absence de numérotation des pages, l'enchaînement non linéaire de l'action, les dessinateurs qui se succèdent...
Bien sûr, il ne faut pas oublier que les différentes chapitres qui composent Black Panther - 1 - Ennemi d'état ont été publiés séparément à la base, vraisemblablement en format kiosque. Les numéros étant espacés dans le temps, les auteurs ont pris la peine, à juste titre, de faire régulièrement des rappels de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents ; sauf que lorsqu'on lit tout d'une traite, les allusions nous semblent redondantes, forcément. Mais ça reste quand même tout à fait lisible, et on devine que ce travail de tri des épisodes et d'agencement est tout sauf facile.
Des méchants de pacotille à Méphisto
Même si l'action semble partir dans tous les sens, une progression se dessine quand même, au bout d'un moment, jalonnée de "méchants" plus ou moins sérieux à combattre. Le premier à apparaître est Achebe, un paysan schizo qui aurait vendu son âme au diable et qui se balade avec une marionnette qu'il fait parler.
Le Diable, justement, parlons-en. J'ignorais complètement que dans l'univers Marvel, l'un des méchants notables s'appelle Méphisto et qu'il s'inspire du diable de la légende de Faust. Cet album aura eu l'intérêt de me le faire connaître car j'étais complètement passée à côté. Du coup, j'ai mis un peu de temps à comprendre ce que Satan venait foutre dans Black Panther. Depuis, ça a pris du sens évidemment.
Si Achebe est le plus débile et Méphisto le plus vicelard, le plus stylé des super-vilains de cette BD est sans aucun doute Kraven le Chasseur _qui va faire l'objet d'un film l'année prochaine justement, tiens ! Je n'ai pas bien compris ce qu'il apportait à l'histoire en l'occurrence, mais ce personnage est une expérience à part entière, visuellement !
Clichés démontés
Le premier feuilletage/lecture en diagonale de l'album m'a laissée dubitative : un méchant Russe, un réfugié arborant une ceinture d'explosifs, un héros débarquant d'Afrique avec toute "sa smala" (c'est traduit comme ça) sous le regard surpris des Américains, escorté de deux "épouses" _ les Dora Milaje. Je me suis dit que ça allait être riche en idées reçues ; et encore, je n'avais repéré ni les dealers mexicains, ni le patron vénère du resto chinois.
Heureusement, la plupart de ces clichés sont dessinés dans le but d'être (plus ou moins subtilement) détournés : Black Panther considère les Dora Milaje comme des sœurs, des associées. Le massif Zuri, ami de T'Chaka et conseiller - garde du corps de T'Challa, n'est pas seulement une brute épaisse. Le Loup Blanc, frère pâlichon du royaume, a atteint de hautes fonctions militaires sans qu'on l'embête trop avec ses origines extérieures. Les propriétés du vibranium, les
perles kimoyo et autres spécialités du Wakanda, pays d'Afrique mais aussi pays high-tech, sont pas mal exploitées et ont un impact significatif sur l'action.

Le bémol, s'il faut en trouver un, concerne les personnages féminins, bien présents mais relégués à l'arrière plan. Certes, Ross a une patronne, Nikki, mais elle ne prend pas part à l'action. Les Dora Milaje sont des femmes fortes et indispensables à la réussite de T'Challa, mais l'une d'elles va faire les frais de la manipulation de Black Panther par Méphisto. Monica, la fiancée du héros, se retrouve bâillonnée et coincée dans un exosquelette, forcée de flinguer des gens. La belle-mère de Black Panther peine à assurer l'intérim à la tête du Wakanda, en l'absence du roi. Enfin, l'événement déclencheur de cette aventure de la Panthère Noire est le meurtre d'une fillette.
En conclusion, Black Panther - 1 - Ennemi d'État est un album riche en action et en personnages fouillés, à découvrir si vous aimez les histoires de super-héros _ les Avengers débarquent sur la fin, d'ailleurs. Par contre, accrochez-vous, ce n'est pas une lecture facile !
Il y aurait bien d'autres choses à dire sur le travail des trois dessinateurs, qui ont vraiment des styles différentes, mais à ce niveau-là je laisse faire les pros !
Christopher PRIEST. Mark TEXEIRA. Joe JUSKO. Mark BRIGHT. Black Panther - 1 - Ennemi d'État. Panini Comics, 2018. Coll. Marvel Select. 280 p. ISBN 9782809468373